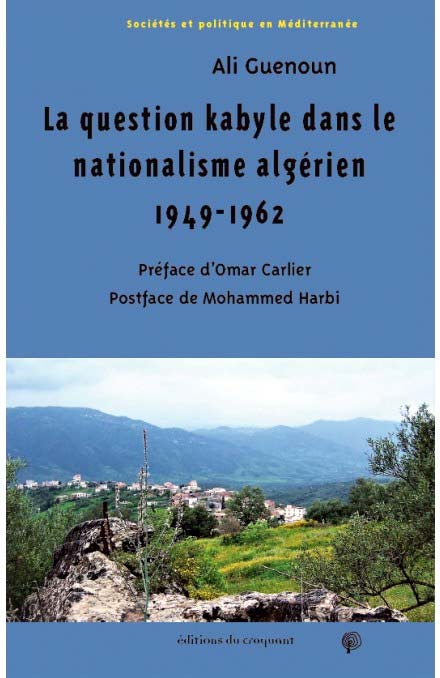Des Kabyles face aux arabo-islamistes au sein du mouvement national algérien.
17 mai 2021
Note de lecture de l’ouvrage « La question kabyle dans le nationalisme algérien 1949-1962. Comment la crise de 1949 est devenue la crise “berbériste” », d’Ali Guenoun.
La présente analyse n’est que partiellement une note de lecture. Elle s’apparente plus à une réaction et à un complément ressenti.
Ali Guenoun est un jeune historien qui vient de publier un ouvrage de référence, et qui, nous l’espérons, en inspirera d’autres. Son travail monumental porte essentiellement sur deux périodes du nationalisme kabyle et son apport incommensurable mettant fin à la colonisation française en 1962.

La première période est consacrée à la crise dite “berbériste” de 1949 au sein du PPA (Parti du peuple algérien). L’auteur démontre que cette crise ne saurait être dénommée « berbériste », mais plutôt « algérianiste ». Analysons que le mouvement amazigh démocratique, pacifique et revendicatif de 1980 a voulu s’en servir comme corpus idéologique, mais ce fut peine perdue.
La seconde période est consacrée à la montée en puissance de la Kabylie durant la décennie 1950. Les Kabyles composaient alors l’immense majorité de la lutte pour l’indépendance (90% selon Benjamin Stora). La fracture de la Fédération de France fut le tournant des vaincus. Des centaines de militants Kabyles furent exclus du PPA. Plus tard, les velléités “berbéristes” furent anéanties dans le sang par les frères de combat. Les homicides politiques ont vu le jour dès 1956. Des militants de premier plan tels que Amar Aït Hamouda, Embarek Aït Menguellat et autre Bennaï Ouali furent assassinés par leurs camarades. Ce dernier point ne semble pas être mis en exergue dans le livre. Notons que les commanditaires de ces liquidations étaient kabyles. Ces derniers furent eux-mêmes exécutés plus tard par le courant arabo-islamiste du FLN. [1]
Ainsi, la violence politique a été augurée par le FLN dès 1956. La décennie noire (1991-2000) en fut machiavéliquement calquée. Le lègue obscurantiste provient conjointement des généraux et des islamistes orthodoxes. A notre encontre évidemment.
Le groupe de Ben-Aknoun et les éléments précurseurs
Pour des raisons d’intégration, l’école française a cherché, aux débuts des années 1940, à constituer une jeune élite lycéenne autochtone. Le groupe indépendantiste dit de Ben-Aknoun s’est ainsi constitué sous l’impulsion d’Ali Laïmèche, nom mythique en Kabylie. A seulement 17 ans, son combat fut doublement précurseur : se débarrasser du joug colonial et affirmer la langue amazighe au sein notamment du PPA. Ce militant-phare décèdera à l’âge de 21 ans, en août 1946, suite à une infection par la typhoïde.
Le groupe de Ben-Aknoun était constitué des éléments suivants : Ali Laïmèche, Hocine Aït-Ahmed, Rachid Ali-Yahia, Amar Ould-Hamouda, Sadeq Hadjerès, Saïd Aïch, Mohand Idir Aït Amrane, Saïd Ali Yahia, Mabrouk Belhocine, Saïd Chibane, Yahia Hennine, Saïd Oubouzar et Omar Oussedik.
« Même si ces jeunes militants n’ont pas été enrôlés dans le militantisme par Bennaï, son rôle dans leur parcours a été déterminant. Ils lui doivent, dans leur majorité, leur ascension dans le parti » rappelle Ali Guenoun (p. 70). C’est lui qui leur inculqua l’esprit de groupe et leur apporta la caution de « père protecteur ». Il fut pour le groupe un conseiller précieux. Mais Bennaï Ouali a surtout, selon A. Guenoun, su « les imposer au sein du parti et leur offrir des postes élevés dans la hiérarchie » (p. 70). Ouali Bennaï a été chargé par la direction du parti d’organiser ces jeunes militants.
Pour la mémoire collective, Laïmèche en était le cerveau, et Bennaï le metteur en œuvre et l’organisateur. Selon le témoignage de Rachid Ali-Yahia, les deux hommes étaient connivents et indissociablement liés.
Les lectures du groupe étaient variées (p. 78). Tout était scruté et discuté : Salluste, Renan, Boulifa, Tawfiq el Madani… Ils ont même osé les écrits d’Hanoteau et Letourneux. Ces deux derniers furent les meilleurs sociologues de la Kabylie de la fin du 19è siècle. Ils ont mis à jour les codes kabyles qui ont permis de vaincre la révolte de 1857 (Icerriḍen), puis celle de 1871 (Sedduq). Notons que la mémoire de Ccix Aḥeddad (révolte patriotique de 1871) est toujours vivace en Basse-Kabylie.
Le groupe de Ben-Aknoun était donc exclusivement constitué de la nouvelle génération kabyle. Une nouvelle élite, dirions-nous. Ces évolués, comme on les appelait alors, aux parcours diversifiés, étaient tous issus de l’école française. Ils se démarquèrent des vieux briscards « incultes ». Cette génération a mis en avant, puis porté, l’identité amazighe du peuple de l’Afrique du nord. Elle fournit de nombreux chants en kabyle sur le nationalisme tels que « Kker a mmi-s umaziɣ », (Lève-toi fils de berbère), ou « A yemma ṣbeṛ ur tru », (Ô mère ne pleure pas). L’indépendance du pays et l’exaltation de tamaziɣt furent leurs principaux leitmotivs. Les auteurs ont enrichi leur prose/poésie en empruntant essentiellement des néologismes provenant du Tamacaq, parler berbère des Touaregs. (p. 80-115).
Leurs écrits mettaient en avant des thèses radicales et révolutionnaires. Ils étaient aux antipodes des affirmations arabistes rétrogrades véhiculées à cette époque mais aussi depuis « l’indépendance ». Les premiers étaient des démocrates révolutionnaires, les derniers étaient recroquevillés sur l’islamo-arabisme inadapté au monde moderne.
De la crise dite « berbériste » de 1949
Cette crise ne fut pas spontanée. Le ver était dans le fruit depuis des lustres. Les différends remontent à 1926, année de la création de l’ENA, ancêtre du PPA. Pour rappel, l’ENA puis le PPA étaient constitués de 90% de Kabyles. Les velléités berbères furent mises sous le boisseau afin de pouvoir intégrer les arabophones. C’est pour cette raison que l’on nommât Messali à la tête du parti. Au détriment du Kabyle Amar Imache, qui pourtant était le plus apte et bien plus brillant. Messali était communiste à l’époque. Il s’habillait à l’occidentale et se mariât avec une anarcho-syndicaliste et féministe. Puis sa rencontre avec Chakib Arslan en Egypte changeât définitivement son parcours. Sous influence, il atteint rapidement « l’effet Peter », i.e. ses responsabilités devinrent nuisibles à toute évolution salvatrice et moderne. Il s’habillera désormais en habits turcs.
La direction du PPA des années 40 était sous domination arabiste. Mais de jeunes Kabyles s’attelèrent à vouloir changer le rapport des forces. Naissent alors deux camps irréconciliables décidés à prendre en main la direction du PPA-MTLD :
- D’une part la vieille direction qui voulait garder la mainmise sur le parti (les islamo-arabistes) ;
- D’autre part la jeune génération innovante. (Les berbéro-matérialistes tels qu’ils furent dénommés plus tard).
Les deux camps échouèrent finalement, et le constat est éloquent et dramatique :
- Le PPA/MTLD a engendré les monstres qui s’appellent FLN et MNA. Ces deux mouvements sont en vérité les deux facettes de la même pièce : islamistes et arabistes sans idiome propre ni culture affirmée du pays.
- Les réfractaires berbéristes renaissants et novateurs se sont effacés. Les autres ont rejoint les rangs du FLN et se sont mis aux ordres.
En bref, la crise de 1949 fut lancinante. Son apogée se fit au sein de la Fédération de France du PPA/MTLD. Rappelons que des centaines de militants kabyles furent conséquemment exclus des structures de ce parti.
La crise s’est évidemment transférée en Kabylie. Les sanctions furent plus dures : n’oublions pas que Krim a été Messaliste jusqu’à l’orée de 1954.
A l’avènement du FLN, des militants taxés de « berbérisme » furent lâchement exécutés par leurs frères kabyles. Ces martyrs s’appellent :
- Amar Ould Hamouda, chef régional de l’OS (Organisation Spéciale), fut assassiné sur les hauteurs de la Kabylie sur les ordres de Krim Belkacem. Son homme de main Amirouche exécuta la sentence.
- Embarek Aït Menguellat, tué en compagnie de Ould Hamouda
- Ouali Bennaï, chef politique de la région kabyle, mitraillé dans son village sur ordre de Abane. Il périt dans un bain de sang devant les siens.
Ces mêmes Krim, Amirouche et Abane furent, à leur tour, exécutés par la frange Arabiste. A nos yeux, l’indépendance de 1962 fut plus une défaire qu’une victoire.
Il est temps d’ouvrir les yeux sur notre passif.
Une nouvelle génération semble prendre le relais. Il faut qu’elle sache et avance comme nous l’avions fait en 80.
Comme a dit Althusser, l’avenir dure longtemps.
Le livre d’Ali Guenoun est à lire ; il nous apporte beaucoup de connaissances sur cet épisode de notre histoire méconnue et sous documentée.
Gérard Lamari
Ali Guenoun, La question kabyle dans le nationalisme algérien 1949-1962. Comment la crise de 1949 est devenue la crise “berbériste”, éditions du Croquant, Paris, 2021, 512 p. (Préface : Omar Carlier, Postface : Mohammed Harbi).
L’ouvrage sera publié prochainement à Alger aux éditions La Casbah.
La question kabyle dans le nationalisme algérien
Dans la même rubrique
- Tagaza : la terre touareg à nouveau ravagée par l’appétit minier du Niger et du Canada
- Bonne année !
- Tamurt-iw, Aẓru
- Amahagh, Amajagh, Amazigh, aret iyen !
- Libye-Italie : Racines communes, visions d’avenir
- HAWAD, lauréat du Prix international du Poète résistant – 2025
- Dictionnaire raisonné berbère - français
- Hawad, le coude grinçant de la poésie
- La monarchie du mépris et de la répression
- "Un contexte répressif aux racines idéologiques anciennes"